On entend souvent dire que les vins suisses d’aujourd’hui sont meilleurs que par le passé. L’amateur de vins suisses est-il devenu plus chauvin ou est-ce une réalité ?
Jusque dans les années ’80, les vins suisses étaient cantonnés à une consommation locale, souvent peu appréciés des consommateurs alémaniques. Aujourd’hui, ils rivalisent avec les plus grands crus, séduisant les palais les plus exigeants.
Il ne fait donc aucun doute que la qualité des vins suisses d’aujourd’hui n’a plus aucune commune mesure avec ce que l’on trouvait sur le marché il y a 30 ans.
Mais alors, qu’est-ce qui a vraiment changé ?
1. Un changement de paradigme
La viticulture industrielle
Durant la deuxième moitié du XXème siècle, le commerce de vins suisses se développe fortement grâce à une politique viticole fédérale protectrice. Pour mieux tirer profit de cette situation favorable, la production s’industrialise.
La viticulture est très rentable, surtout quand les rendements sont élevés. La quantité est alors plus importante que la qualité. Avec le credo que la qualité se fait à la cave, on incite les vignerons à produire un maximum.
La crise de surproduction
Cette façon de voir les choses débouche sur une crise de surproduction due aux vendanges exceptionnelles de 1982 et 1983. La politique viticole fédérale est alors sérieusement remise en cause car, en prime, la tendance est à la globalisation des marchés.
Le système d’importation est modifié suite à l’initiative dite des « importateurs de salons ». En conséquence, le marché se libéralise.
La prise de conscience
L’ouverture des frontières provoque une prise de conscience : dans un marché libéralisé, une viticulture industrielle n’a aucun avenir dans des vignobles en terrasses aux frais de production élevés.
L’avenir de cette activité traditionnelle n’a d’autre choix qu’une mise en valeur de l’identité et de l’originalité de ce vignoble de terrasses qui s’est construite sur une longue tradition avec des cépages autochtones, des sols et un climat marqués par un environnement alpestre incomparable.
Les AOC et la qualité
En conséquence, la vision change et la qualité devient un objectif central. Les Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) sont progressivement mises en place dès 1991.
Cela implique entre autres :
- Une limitation des rendements
- Des exigences accrues des teneurs minimales de sucre requises
- Un contrôle de l’état sanitaire des raisins
Les échelles de paiements des vendanges sont redéfinies en vue de favoriser la qualité. Le degré de maturité est mieux pris en considération et les cépages plus difficiles à cultiver (spécialités) sont mieux rémunérés.
2. Une nouvelle génération de producteurs
Une nouvelle génération de vignerons formés, pour la plupart à l’école de Changins, et ayant suivi des stages pratiques à l’étranger apportent une nouvelle dynamique.
On prend conscience que sans raisins de qualité, la cave ne peut faire de grands vins. Sous leur impulsion combinée à l’évolution du marché, les pratiques viticoles traditionnelles vont être fondamentalement changées.
La tâche première du vigneron n’est plus de maximiser le rendement, mais de rechercher la qualité. Cette prise de conscience est déterminante et signifie le commencement d’une nouvelle ère basée sur la qualité.
Les vins suisses reprennent des couleurs et retrouvent une identité par la valorisation de l’identité des cépages au détriment des sélections clonales développées pour assurer des rendements juteux. Cette tendance va profiter en particulier aux cépages indigènes.
3. Des réglementations et formations renforcées
Nouvelles pratiques viticoles
Concrètement, les vignerons adoptent des pratiques favorables à la qualité et abandonnent progressivement les pratiques industrielles. L’introduction des AOC avec limitation des rendements implique notamment :
- Une forte diminution de l’utilisation d’engrais chimique
- Une taille plus sévère afin de diminuer le nombre de grappes par ceps
- La suppression des grappes excédentaires
- Des vendanges en vert pour éliminer les grappes ou parties de grappes qui n’arriveront pas à maturité. Ainsi les raisins restants atteindront une pleine maturité homogène
- La suppression de l’irrigation à la veille des vendanges pour faire gonfler le raisin. Le maître mot est devenu « concentration » au détriment de « quantité »
- Le tri de la vendange à la vigne. Cela consiste à éliminer les grappes qui n’ont pas complètement mûri. Seuls les raisins parfaitement propres, sains et bien mûrs sont apportés à la cave
Fini le temps où les enfants devaient aider à la vigne et ramasser les grains tombés par terre. Aujourd’hui on amène à la cave que des raisins sains et bien mûrs.
Le prix de la révolution
L’introduction des règlements d’appellation d’origine contrôlée n’a pas fait que des heureux car cette révolution a un prix. Concurrence oblige, sous la pression du marché, les producteurs de raisins voient le revenu de leur travail fortement diminuer.
Le travail de la vigne n’est plus aussi rémunérateur que par le passé. Les pratiques visant à maîtriser les quantités produites se sont donc souvent heurtées à de fortes résistances. On a fréquemment entendu « C’est un péché d’enlever ce que Dieu a donné ».
Un avenir optimiste
Par contre, les vins suisses peuvent maintenant voir l’avenir avec optimisme car ils ont affirmé leur identité et confirmé la légitimité de la viticulture en zone alpine, même dans un marché libéralisé.
L’évolution de l’encépagement
L’évolution de l’encépagement du vignoble valaisan reflète parfaitement cette nouvelle recherche de qualité et d’identité. Les surfaces plantées en Pinot noir, Gamay et Chasselas diminuent fortement au bénéfice des spécialités qui se voient bien mieux valorisées.
Dans les faits, on constate qu’en 1991 les 3 cépages principaux (Pinot noir, Gamay et Chasselas) représentaient 87,2% du vignoble. En 2023 ils ne représentent plus que 53,7%.
Ainsi donc durant cette période, les surfaces des 3 principaux cépages diminuent de près de moitié (4’592 → 2’486 ha) alors que dans le même temps les surfaces cultivées en cépages autochtones sont multipliées par 5 (121 → 637 ha).
Les surfaces de Petite Arvine passent de 39 à 260 ha. Celle de Cornalin de 14 à 163 ha.
La revalorisation des cépages autochtones souligne l’originalité des terroirs valaisans et préserve l’incomparable valeur patrimoniale paysagère des vignobles en terrasses. Vous souhaitez connaître la liste des cépages les plus répandus en Suisse et comprendre ce qui les rend si uniques ? Parcourez notre guide complet pour découvrir leur richesse et leur diversité.
4. Une évolution encore en cours
Les changements des 4 dernières décennies sont spectaculaires. Le vignoble a changé de visage. Non seulement l’encépagement mais les modes de culture ont évolué.
Les vignes cultivées sur fil ont remplacé les gobelets, l’enherbement permanent est une pratique courante et possible grâce à l’irrigation au gouttes-à-gouttes, les vignes ne sont plus plantées dans le sens de la pente mais en banquettes perpendiculaire pour permettre une mécanisation.
Ainsi donc, ce vignoble vieillissant est encore appelé à changer. Sous l’effet du réchauffement climatique, on pourrait voir apparaître des cépages typiques des vignobles méridionaux tels que Malbec, Mourvèdre voire même Grenache ou Tempranillo.
On constate aussi l’arrivée des cépages résistants (PIWI) qui permettent de répondre à l’attente de consommateurs soucieux de l’environnement.
5. Une révolution aussi dans les caves
Pendant ce temps, les caves ont aussi connu une véritable révolution œnologique. Les vignerons ont adopté des techniques modernes et des outils innovants pour améliorer la qualité des vins. Mais surtout, l’hygiène et une propreté irréprochable sont devenues la norme.
Équipements modernes
Les caves suisses se sont donc équipées de machines modernes pour optimiser chaque étape de la vinification. Par exemple :
- Des pressoirs pneumatiques pour une extraction plus douce des jus
- Des cuves en inox avec contrôle de la température pour une fermentation précise
- Des systèmes de filtration modernes pour garantir une pureté optimale
- Un contrôle précis des températures pendant la fermentation
- Une utilisation de cuves en inox et de barriques adaptées
- La multiplication du nombre de petites cuves pour permettre des sélections parcellaires et la vinification individualisée de chaque cépage
Ces innovations permettent de mieux préserver les arômes de chaque cépage, de produire des vins plus fins, équilibrés, avec une meilleure structure et complexité aromatique.
6. Une viticulture responsable
Les vignerons suisses ont également adopté des pratiques respectueuses de l’environnement. L’utilisation de produits bio et la réduction des intrants chimiques sont devenues des priorités. Voici quelques exemples concrets :
- Utilisation de produits naturels pour protéger les vignes
- Réduction de l’usage de sulfites pendant la vinification
- Gestion raisonnée de l’eau pour préserver les ressources locales
Ces efforts s’inscrivent dans une volonté d’optimiser l’expression du terroir tout en répondant à une demande croissante des consommateurs pour des vins plus respectueux de l’environnement.
En conséquence, de nombreuses caves optent pour une viticulture biologique voire même vers la pratique de la biodynamie.
7. Récompenses et distinctions récentes
Autrefois peu exportés, les vins suisses gagnent aujourd’hui en visibilité grâce aux médailles et distinctions remportées dans des concours internationaux. Cette reconnaissance est le résultat des efforts consentis pour améliorer la qualité.
Les vignerons suisses ont pris conscience qu’ils ont leur place sur le marché mondial.
Concours prestigieux
Ces dernières années, de nombreuses récompenses ont été décernées lors de concours prestigieux comme :
- Le Concours Mondial de Bruxelles
- Les Vinalies de Paris
- Les sélections mondiales du Canada
- Le Decanter World Wine Awards
Ces distinctions témoignent de l’évolution qualitative des vins issus de régions comme le Valais ou le Vaud mais aussi du Tessin, des Grisons ou de Suisse alémanique.
En fait, toutes les régions viticoles de Suisse ont suivi le mouvement et, ainsi donc, on trouve à l’heure actuelle des vins exceptionnels dans tous les cantons.
Principales distinctions internationales récentes
Varone Vins

Stricto Sensu 2018
- Grand Or aux Vinalies de Paris en 2023
- Le Decanter 2023 – 95 points
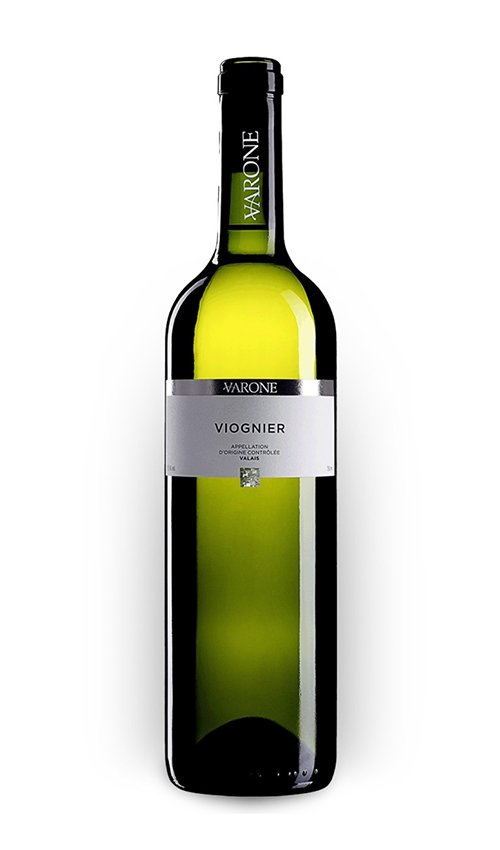
Viognier 2022
- Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2023
Bonvin 1858
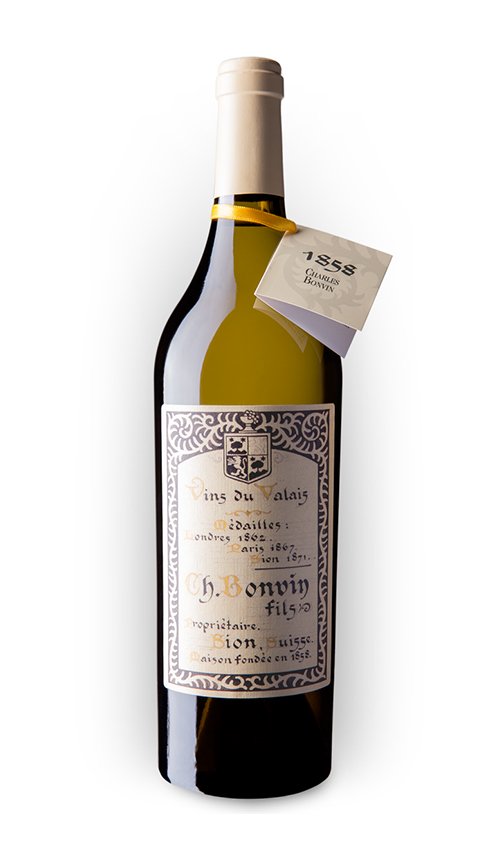
Cuvée 1858 Blanc 2021
- Médaille d’Or aux Vinalies 2024
- Decanter 2022 Platinum 97/100 (Plus haute distinction du concours)
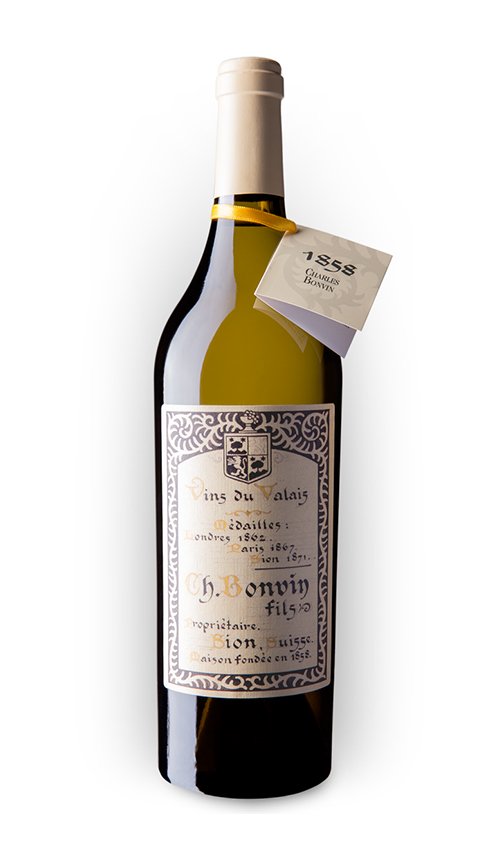
Cuvée 1858 Blanc 2022
- Parker 2025 – 92 points
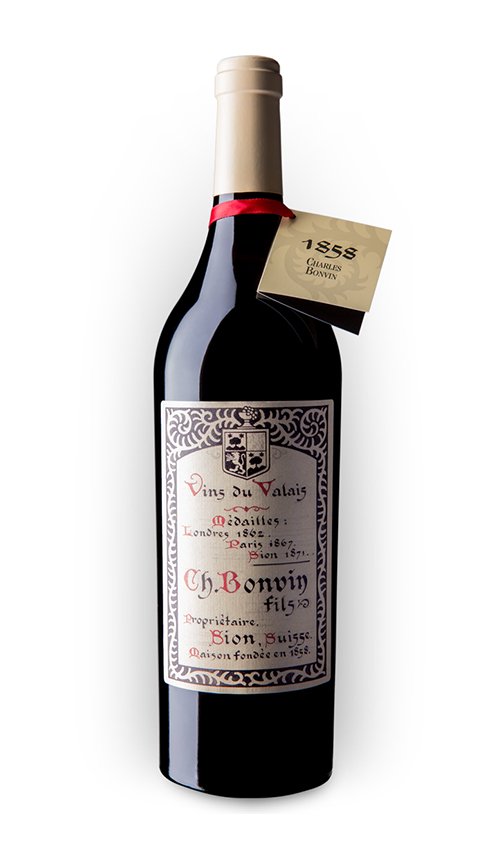
Cuvée 1858 Rouge 2020
- Médaille d’or aux Vinalies de Paris 2023
- Médaille d’or au Mondial de Bruxelles 2025
- Parker 2025 : 90 points

Cuvée 1858 Brut 2018
- Or Mondial de Bruxelles 2025
Il y a 20 ans, les vins suisses étaient souvent perçus comme modestes, destinés principalement à une consommation locale.
Les changements initiés dans les années ’90 ont permis l’avènement des vins suisses de qualité qui respectent la personnalité des cépages et la typicité des terroirs.
Aujourd’hui, ils brillent sur la scène internationale et ils ont gagné reconnaissance et respect sur le plan mondial mais aussi et surtout en Suisse.


















